Ah l’Inquisition. S’il y a bien une institution médiévale qui a une réputation sinistre, c’est celle-là. Le terme “Inquisition” évoque en général des images très sombres, comme la torture, les bûchers, le fanatisme religieux pour n’en citer que quelques unes. L’Inquisition c’est cruel, c’est sordide, et c’est bien la preuve que le Moyen âge était une période atroce. Cette image de l’Inquisition médiévale est très tenace, notamment parce qu’on la retrouve souvent dans les médias de divertissement quand on veut créer un antagoniste bien cracra, comme l’archétype de l’inquisiteur pervers et cruel qui va torturer et condamner à mort des innocents pour un oui ou pour un non.
Pour ne citer qu’un exemple, prenons l’adaptation du Nom de la Rose par Jean-Jacques Annaud en 1986 qui, on le rappelle, est tirée du roman du même nom d’Umberto Ecco. Dans le Nom de la Rose on retrouve notamment le personnage de Bernardo Gui, qui est un inquisiteur qui a réellement existé et dont la représentation dans le film est tout sauf flatteuse. Après, le vrai Bernardo Gui était peut-être effectivement comme ça, mais vu qu’il est mort au XIVe siècle, on n’en sait rien, et le pauvre vieux n’est plus là pour se défendre. Mais quoi qu’il en soit, la représentation de cette figure de l’inquisiteur est très stéréotypée, puisque à peine ce personnage arrive que trois personnes se retrouvent accusées de sorcellerie et d’hérésie, torturées, évidemment, pour les faire avouer, et dans les deux ou trois jours qui suivent sont condamnés au bûcher. Autre exemple, tiré cette fois ci des jeux vidéo. Dans le jeu A Plague’s Tale: Innocence, paru en 2019 et dont l’action se situe au XIVe siècle dans l’ancienne province de Guyenne, située donc en France actuelle, les deux protagonistes, une adolescente et un petit garçon, sont poursuivis sans relâche par l’Inquisition, qui massacre tout le monde sur son passage pour essayer de les choper. Alors oui, le jeu n’a pas prétention à être réaliste, mais le fait est que de nouveau l’idée générale est la même, à savoir que l’Inquisition, c’est des gros méchants sans scrupule.

Alors on va clarifier tout de suite que le but de cet épisode c’est pas de dire que l’Inquisition c’était magnifique, qu’il n’y a jamais eu d’abus et qu’aucun innocent n’est jamais mort dans d’atroces souffrances. Il s’agira simplement de remettre quelques éléments historiques dans leur contexte et de démêler le vrai du faux.
On va justement commencer par une distinction très importante dont les gens ont rarement conscience, à savoir que l’Inquisition médiévale et l’Inquisition espagnole, ce sont deux choses différentes. L’Inquisition dont on va parler aujourd’hui c’est l’Inquisition médiévale, pontificale, puisqu’elle est placée sous l’autorité du pape. Cette Inquisition ne concerne, en gros, que les deux derniers siècles du Moyen âge, soit environ entre 1300 et 1500 après J.-C. Le but de cette Inquisition pontificale n’était pas, comme on le pense souvent, de traquer les païens et autres sympathisants du diable, mais de ramener les fidèles dans le droit chemin. Elle visait donc les chrétiens, plus spécifiquement les chrétiens dont la vision et la pratique du christianisme était différente de celle voulue par la papauté. Je reviendrai plus tard sur ce que cela signifie d’être “correctement chrétien” à cette époque. L’Inquisition espagnole, par contre, est venue après et visait cette fois-ci ce qu’on appelait les “faux convertis”, à savoir les juifs et les musulmans qui s’étaient convertis en apparence au catholicisme, pour qu’on les laisse tranquilles, mais qui continuaient à pratiquer leur réelle religion en cachette. Cette Inquisition-là a été établie en 1478 à la demande de la reine de Castille et du roi d’Aragon, afin qu’ils aient le droit de nommer eux-mêmes leurs propres inquisiteurs sans avoir à passer par le pape. C’est donc une évolution de l’Inquisition pontificale, certes, mais une institution distincte malgré tout, et il se trouve qu’en général, quand on pointe du doigt l’Inquisition pour ses “excès de zèle” contre les non-catholiques, c’est le plus souvent cette Inquisition-là qui est en cause.
Enfin, un petit mot sur l’Inquisition et les sorcières. Alors. Oui, pendant le Moyen âge, il y a bien eu aussi des procès et des condamnations à l’encontre de personnes qui étaient accusées d’invoquer des forces surnaturelles et de vouer un culte au malin. Mais ce n’était de loin pas l’essentiel de l’activité de l’Inquisition pontificale. Et, pour information, l’apogée de ce qu’on appelle communément la “chasse aux sorcières”, c’était entre le XVIe et le XVIIe siècle, et donc bien après la fin du Moyen âge. De fait, vouloir faire porter le chapeau au Moyen âge pour les bûchers de sorcières à tous les coins de rue, et s’en servir comme argument pour dire que c’était une période de barbares, c’est complètement faux et anachronique, de même que ceux qui disent que ces sales inquisiteurs du Moyen âge ont cramé Galilée parce qu’il a dit que la terre tournait autour du soleil. Raté, encore une fois, puisque non seulement Galilée est né en 1564, donc bien après la fin du Moyen âge, mais en plus il n’a pas du tout été condamné à mort. Il a été assigné à résidence, pas chouette non plus, mais c’est quand même moins pire. Voilà, je ferme la parenthèse.
Revenons en maintenant à l’Inquisition pontificale et au contexte qui l’a vu naître. Ce qu’il est important de garder à l’esprit ici, c’est que la société médiévale est une société pour laquelle la question de la préservation de la foi revêt la même importance que, par exemple, la préservation de la santé publique dans notre société moderne. Pour le croyant de l’époque, l’Eglise était parfaitement dans son droit en exerçant un pouvoir de juridiction là-dessus. Un autre point qu’il est essentiel de garder à l’esprit, c’est que l’unité de la foi était un concept primordial pour l’Eglise médiévale. Mais qu’est-ce qu’on entend par “unité de la foi”? Contrairement à ce qu’on pourrait penser aujourd’hui, il n’était pas seulement question que “tout le monde soit chrétien”, mais il fallait aussi que tout le monde soit correctement chrétien, dans le sens de l’interprétation des Ecritures. Ce qui pourrait sembler être un point de détail, après tout on pourrait se dire qu’une interprétation est propre à chacun, et bien ça ne l’était pas du tout au Moyen âge. L’Eglise définissait une interprétation, une doctrine officielle, et être en désaccord avec cette doctrine, c’était être un hérétique.
Et donc, qu’est-ce qu’il se passe au cours du XIIe siècle? Le nombre d’hérétiques augmente au sein de la chrétienté. Il y a bien évidemment une multitude de facteurs qui expliquent cette augmentation, mais un des plus importants est le mécontentement grandissant des populations à l’encontre du clergé. L’Eglise étant l’intermédiaire entre la population et Dieu, son rôle est central, c’est un des piliers, sinon LE pilier, de la société médiévale. Mais il y a un problème: ses représentants, comme les prêtres ou les évêques qui sont censés être exemplaires en raison de leur rôle et de leur statut, semblent être devenus l’incarnation même du péché. Par exemple, ils s’enrichissent, notamment en se faisant payer d’avance des prières qu’ils ne vont pas faire, ils exploitent des terres pour leur propre profit, ils s’adonnent à la luxure alors qu’ils sont censés avoir fait vœux de chasteté, etc. etc. Autant dire qu’auprès de la population ça passe très mal, et que la confiance envers le clergé et ses représentants est au plus bas. C’est donc dans ce climat de défiance que des mouvements dissidents, des mouvement hérétiques, vont se développer, et que la nécessité de créer ce qui va devenir l’Inquisition va apparaître.
Tout au long du XIIe siècle, un nombre important de conciles, assemblées d’évêques en général présidées par le pape, seront consacrés à cette question de la lutte contre l’hérésie. Différentes mesures, différentes procédures vont être instituées avec plus ou moins de succès. Pendant un certain temps, c’est aux évêques eux-mêmes que reviendra la charge de s’occuper des problèmes d’hérétiques dans leur propre diocèse, qui disposait alors de son propre tribunal. C’est en 1232 que cela va changer, car sous le pontificat de Grégoire IX, la charge de rechercher et de juger les hérétiques, sera confiée à l’ordre des frères Dominicains, puis aussi des Franciscains dès l’année suivante. Ces deux ordres, l’ordre des Dominicains et des Franciscains, ont la particularité d’être en permanence au contact de la population et de beaucoup se déplacer, notamment pour aller prêcher en milieu urbain, au contraire d’autres communautés religieuses qui vivaient de manière isolée. Leur mode de vie les prédisposait donc naturellement à cette mission. Dans le cadre de leur mission de chasse aux hérétiques, si on veut bien, les frères Dominicains et Franciscains vont répondre directement à l’autorité du pape. Les évêques n’ont donc plus le “lead”, et leur rôle se limitera désormais à celui d’aider, et de mettre à disposition des inquisiteurs envoyés par le pape ce dont ils ont besoin. Cette nouvelle juridiction prend alors le nom d’Inquisition, et entre officiellement en action en 1233 dans la région de Toulouse.
Contrairement à ce qu’il est commun de penser, l’Inquisition ce n’est pas juste une flopée d’inquisiteurs lâchés dans la nature pour faire ce que bon leur semble. C’est réellement une juridiction avec des procédures clairement définies. Quatre étapes notamment forment la base de la procédure des inquisiteurs. La première étape, c’est l’enquête. Ensuite vient la convocation des personnes soupçonnées, puis l’interrogatoire, et enfin le jugement. Lorsque une région était soupçonnée d’abriter un nid d’hérétiques, un inquisiteur était en général désigné par le pape pour s’y rendre. Une fois sur place, l’inquisiteur promulgait alors deux édits:
- Le premier, l’édit de foi, statuait que toute personne connaissant des hérétiques se devait de les dénoncer sous peine d’être excommunié.
- Le second, l’édit de grâce, accordait un délai au cours duquel un hérétique, ou un sympathisant à la cause hérétique, pouvait venir se dénoncer spontanément en échange d’une peine réduite. “Faute avouée à moitié pardonnée”, comme on dit.
Une fois le délai de grâce expiré, on constituait alors le tribunal. L’inquisiteur n’était pas tout seul dans son coin à décider de qui allait vivre ou mourir sur un coup de tête, on parle bien ici d’un tribunal complet composé de différents membres. Notamment: l’inquisiteur (ou son délégué), des commissaires, un jury composé d’hommes dits de bonne réputation, un notaire, et enfin et SURTOUT, des scribes, qui avaient pour tâche de retranscrire tous les procès, comme le font encore les greffiers d’aujourd’hui. Et c’est grâce à leur travail, et au soin qui a été pris dès le départ à la conservation de ce type de documents, que certains procès complets sont parvenus jusqu’à nous, tant de siècles plus tard.
Il y a un point qu’il faut qu’on aborde maintenant parce qu’on ne peut pas l’éviter quand il s’agit de l’Inquisition, c’est la question du recours à la torture pendant la phase d’interrogatoire de la procédure. En théorie, l’usage de la torture, à partir du moment où il a été autorisé en 1252, était strictement règlementé et était réservé aux cas où les interrogratoires “standards” n’aboutissaient pas et où les soupçons étaient déjà graves et appuyés par des indices sérieux. En d’autres termes, on ne pouvait utiliser la torture que si on était déjà relativement sûr de son coup. Il était aussi de bon ton, en principe, d’éviter les mutilations de membres et il fallait tout de suite s’arrêter en cas de risque de mort pour l’accusé. Un dernier détail, mais pas des moindres, c’est que pour que les aveux obtenus sous la torture soient recevables, il fallait qu’ils soient répétés vingt-quatre heures après et que l’accusé déclare les avoir donnés de son plein gré. Problème, comme on l’imagine, il n’était pas rare qu’une fois sortis de la salle de torture, les accusés rétractent leurs aveux. Rien d’étonnant à cela, il est facile de concevoir que dire au bourreau ce qu’il veut entendre est le moyen le plus efficace pour que la torture s’arrête, et cela ne veut pas forcément dire que c’est vrai. Parade pour se sortir de ce petit problème: l’Eglise considérait que la confession initiale était la manifestation de la vérité et que c’était la rétractation qui était le mensonge. Donc se rétracter, c’est un parjure, et donc la preuve que l’accusé était coupable. L’art de toujours retomber sur ses pattes.
Donc oui, l’association Moyen âge – Inquisition – torture, même si j’aimerais pouvoir vous dire le contraire, pour le coup elle est quand même bien basée sur des réalités historiques. Mais, pour nuancer quand même la vision qu’on peut en avoir, le recours à la torture n’était de loin pas systématique, et même s’il est très certain qu’il y a eu des abus et des excès, c’était quand même une pratique encadrée et qui était loin de faire l’unanimité au sein même de l’Inquisition. Pas tous les inquisiteurs étaient des fous du chevalet, loin de là. Mais il y en a quand même eu.
Au même titre que la torture, la question du recours à la peine du bûcher, et des sentences en général, mérite qu’on s’y intéresse. Après tout, le bûcher est un peu le best seller des images associées à l’Inquisition dans l’imaginaire collectif. Mais qu’en était-il en réalité?
Comme on l’a vu précédemment, le but des inquisiteurs en partant à la chasse aux hérétiques, ce n’était pas de les éradiquer au sens physique du terme, mais de les sauver en les ramenant dans le droit chemin. Donc condamner un hérétique à mort, c’était un aveu d’échec de la part de l’inquisiteur, puisque cela signifiait qu’il n’avait pas réussi à le convaincre de ses erreurs et à le ramener sur la voie du salut, et ainsi à sauver son âme. Le bûcher était donc vraiment un dernier recours, ce qui à nouveau ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’abus. Un petit rival politique qui se retrouve accusé d’hérésie et qui part au bûcher vite fait bien fait, ça c’est déjà vu, et c’est pas le propre du Moyen âge mais un des penchants naturels de l’être humain. Il faut cependant s’enlever de la tête l’idée que des hérétiques condamnés au bûcher étaient amenés par dizaines dans des charrettes toutes les semaines et qu’il y avait des bûchers à tous les coins de rue. En fin de compte, proportionnellement aux autres peines beaucoup plus légères qui étaient prononcées, les condamnations à mort étaient assez rares. Les écrits de Bernardo Gui, l’inquisiteur représenté dans le Nom de la Rose mentionné en début d’épisode, nous permettent de nous faire une idée des différents types de peines et de leurs fréquences. Dans son Livre des sentences plus spécifiquement, où il documente son activité d’inquisiteur à Toulouse entre 1307 et 1323, moins de 5% des 636 sentences prononcées étaient des condamnations au bûcher. Comme autres peines, il y avait par exemple: devoir réciter des prières, payer une amende ou jeûner pendant un certain nombre de jours, pour les peines relativement légères. Pour les peines un peu plus lourdes, on pouvait par exemple être contraint à un pèlerinage, où se faire confisquer tous ses biens. On pouvait également être condamné à ce qu’on appelait le “mur”, qui équivaut à une peine d’emprisonnement. Enfin il y avait aussi la catégorie des peines dites infamantes, qui avaient pour but de ternir la réputation des condamnés en rendant leur pêché visible aux yeux de tous en leur faisant porter une croix en feutre rouge ou jaune sur leurs vêtements. Les inquisiteurs avaient donc à leur disposition tout un arsenal de sentences autres que le bûcher.

Dans cet épisode, on a beaucoup mentionné ces fameux hérétiques, qui étaient des chrétiens, mais pas des chrétiens comme il fallait. Comme il peut être un peu compliqué de s’imaginer vraiment en quoi cela consistait, terminons cet épisode par un exemple concret de groupe d’hérétiques: les vaudois. Evidemment il ne s’agit pas ici de nos voisins du canton de Vaud, même si j’ai choisi cet exemple exprès pour pouvoir faire cette blague. Les vaudois, du nom de leur leader Pierre Valdès, ou Vaudès, c’est selon, formaient un groupe de dissidents à la fin du XIIe siècle. Ils suivaient donc les préceptes de Pierre Valdès, un riche marchand lyonnais qui avait abandonné ses richesses, et accessoirement sa famille, pour partir prêcher le retour à la pauvreté apostolique. Quand on entend ça, on pourrait simplement se dire “bah, ils ont envie de vivre dans la pauvreté et de renier les biens matériels – c’est leur histoire, grand bien leur fasse, ils ne font de mal à personne”. Sauf que non, car Pierre Valdès, et ses disciples après lui, avaient également rejeté l’autorité de l’Eglise dans leur doctrine. Ils considéraient notamment que des sacrements qui étaient conférés par des prêtres corrompus et/ou sans vertu n’avaient aucune valeur, et qu’à ce titre eux-mêmes, vertueux, étaient d’autant plus légitimes à administrer des sacrements et à prêcher la bonne parole. Comme on peut s’en douter, ce type de courants de pensées n’était pas bon du tout pour l’Eglise, qui basait la légitimité même de son existence sur son rôle d’intermédiaire indispensable entre le divin et la population. Donc si au final, la prière et la parole de tout le monde a la même valeur aux yeux de Dieu, alors l’Eglise et surtout ses représentants, n’ont plus raison d’être.
L’exemple de l’hérésie vaudoise est un exemple parmi d’autres. Ce qu’il faut retenir, c’est que c’est ce type de courants de pensées considérés alors comme dissidents que la papauté va tenter d’endiguer pendant toute cette période, afin de préserver l’unité de la foi catholique, et de fait, sa propre autorité.
Et voilà, vous savez tout – ou presque – sur l’Inquisition médiévale!
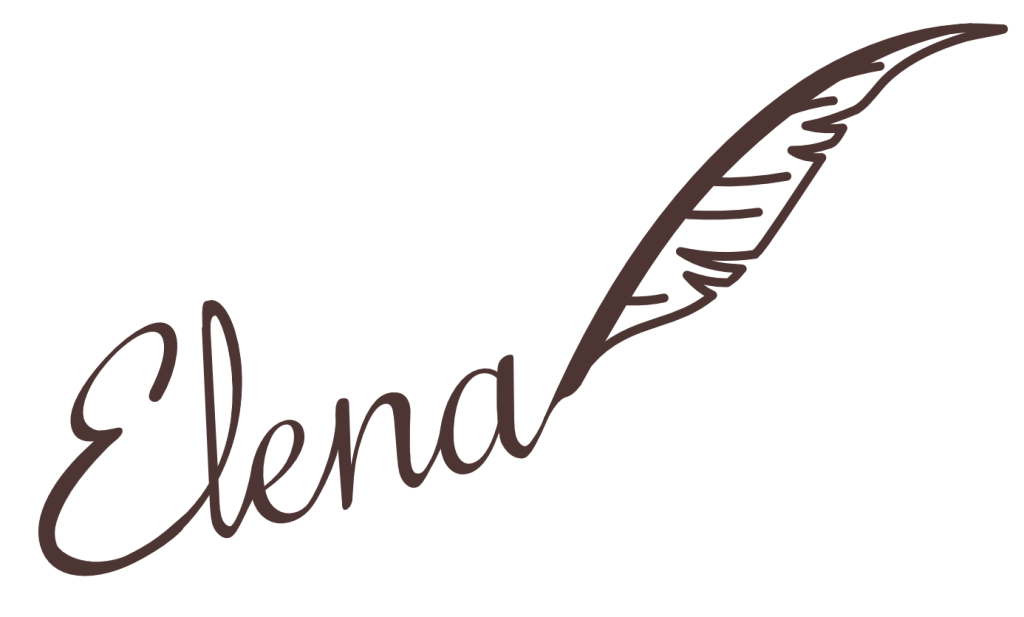
Pour en savoir plus…
François de Lannoy, Histoire secrète de l’inquisition, Ouest-France (2021)
Didier Le Fur, L’Inquisition, enquête historique : France, XIIIe-XVe siècle, Tallandier (2012)